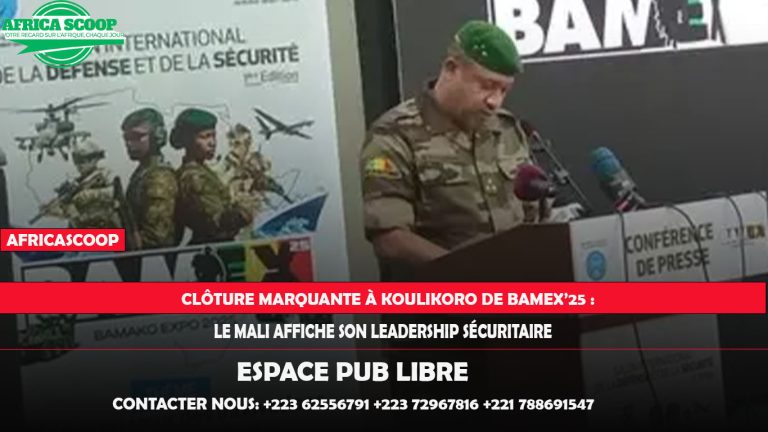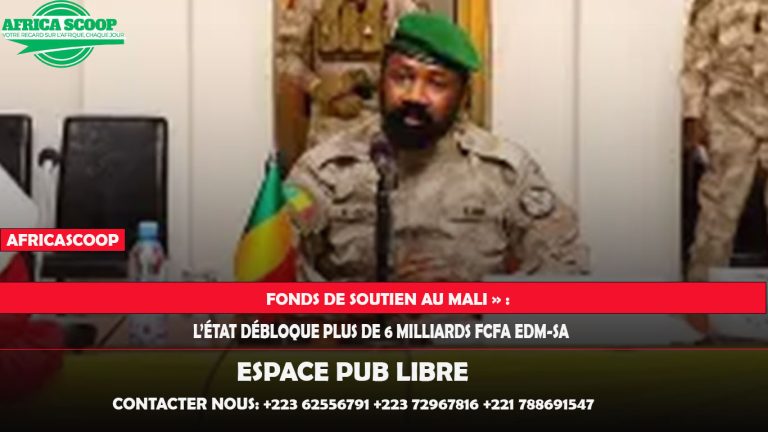Dans une tribune dont nous avons obtenu copie, le président du Réseau pour la défense des droits humains au Mali (RDDHM), Souleymane Camara, estime que le système judiciaire malien, pilier fondamental de l’État de droit, traverse depuis plusieurs années une crise de crédibilité. Retards, absentéisme, lenteur des procédures, corruption et manque de rigueur ternissent l’image de la justice et compromettent les droits des justiciables.
Face à ce constat, il formule plusieurs propositions de critères de performance et d’évaluation des juges afin d’améliorer la qualité du service rendu et de restaurer la confiance du public.
Une indépendance de la justice souvent mal comprise
Selon Souleymane Camara, la notion d’indépendance de la justice est trop souvent confondue avec un « laisser-aller » généralisé. « L’indépendance ne signifie pas impunité », rappelle-t-il, dénonçant le comportement de certains magistrats qui bafouent les règles professionnelles et les horaires de travail.
Retards, absentéisme et impunité : les maux qui gangrènent le système
Les retards et absences injustifiés des juges constituent, selon lui, l’un des problèmes majeurs. Dans de nombreux tribunaux, des magistrats arrivent entre 10 h et 12 h, alors que la journée de travail débute officiellement à 7 h 30. « Certains quittent même les bureaux avant la fin du service, entraînant un ralentissement considérable du traitement des dossiers et un allongement des détentions préventives », déplore-t-il.
Ces pratiques, ajoute-t-il, nuisent gravement aux droits des citoyens et accentuent le surpeuplement carcéral. Autre difficulté pointée : la quasi-impossibilité de poursuivre un juge fautif. « Bien que nul ne soit au-dessus de la loi, le parquet rechigne souvent à engager des poursuites contre ses pairs. Les citoyens craignent d’ailleurs des représailles lorsqu’ils osent dénoncer un magistrat. Cette solidarité corporatiste nourrit un sentiment d’impunité et d’injustice », souligne M. Camara.
Des faiblesses structurelles et une formation insuffisante
Le rapport évoque également des carences structurelles : corruption, manque de moyens, lenteur des procédures et absence de tribunaux dans certaines zones rurales.
La formation des juges, assurée à l’Institut national de formation judiciaire (INFJ), est jugée trop courte deux ans seulement et trop théorique. Cette durée, selon l’auteur, ne permet pas d’acquérir une expérience suffisante pour rendre des décisions solides et bien motivées.
Des critères de performance proposés
Pour inverser la tendance, Souleymane Camara propose plusieurs mesures parmi lesquelles figurent l’allongement la formation des juges à trois ans, avec des stages de perfectionnement réguliers ; l’instauration d’un système d’évaluation continue, fondé sur la ponctualité, la qualité des décisions rendues et le respect des délais de jugement (quatre mois maximum pour la tenue d’un procès, deux mois pour la rédaction de la décision) ; le renforcement des moyens de l’Inspection des services judiciaires, afin qu’elle puisse effectuer des contrôles rigoureux et réguliers.
Une justice à reconstruire
Dans sa conclusion, le défenseur des droits humains déplore « le laxisme et l’absence de rigueur » qui caractérisent actuellement le système judiciaire malien. Selon lui, ces faiblesses alimentent l’impunité, la violence et la méfiance du public vis-à-vis des institutions.
Il appelle à une réforme profonde de la justice, fondée sur la responsabilité, la transparence et la compétence, afin que les Maliens retrouvent confiance en leurs tribunaux.
Par Lamine Bagayogo