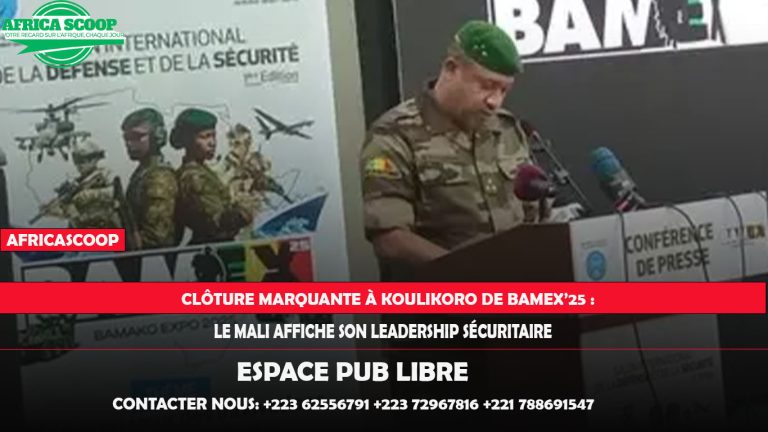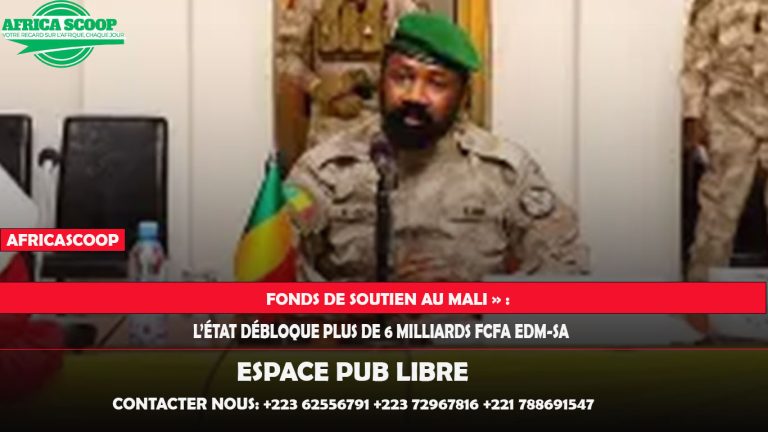Le Mali traverse l’une des crises humanitaires les plus graves de son histoire récente. L’insécurité persistante, alimentée par les violences armées et les attaques terroristes, continue de fragiliser un pays déjà marqué par plus d’une décennie de conflit. Les régions du Nord et du Centre, épicentres de cette instabilité, paient le plus lourd tribut.
Selon un rapport publié en janvier 2025 par le Bureau de la coordination des affaires humanitaires des Nations unies (OCHA Mali), plus de 6,4 millions de Maliens présentent aujourd’hui des besoins humanitaires multisectoriels : sécurité alimentaire, santé, eau potable, protection des civils et éducation.
Chaque mois, des milliers de familles fuient leurs villages, poussées par les violences armées et les représailles communautaires. Les déplacements internes s’ajoutent à l’arrivée de réfugiés en provenance de pays voisins, eux-mêmes confrontés à l’instabilité.
Dans plusieurs localités du Nord et du Centre, les marchés hebdomadaires ne se tiennent plus, les écoles restent fermées et les centres de santé tournent au ralenti, faute de personnel et de moyens. Les ONG dénoncent aussi de sérieuses entraves à l’accès humanitaire, notamment dans les zones enclavées contrôlées par des groupes armés.
Les autorités tentent de rassurer
Abdraman Togora, coordinateur national des sites de personnes déplacées internes au ministère de la Santé et du Développement social, assure que la situation est « maîtrisée », grâce à des mécanismes visant à réduire la dépendance à l’assistance humanitaire. « Les priorités consistent à fournir une aide d’urgence et à trouver des solutions durables, pour que les déplacés deviennent autonomes et puissent aider d’autres personnes », explique-t-il.
Selon ses chiffres, à la date du 31 décembre 2024, le Mali comptait 402 167 déplacés internes, 88 783 rapatriés et 863 697 personnes retournées dans leurs localités d’origine. Toutefois, il reconnaît les difficultés d’accès à certaines zones, notamment Ménaka. « Nous avons les moyens de soutenir les populations, mais l’accès reste le principal obstacle », confie-t-il.
Ménaka, symbole d’une crise aiguë
À Ménaka, les témoignages sont alarmants. Almahmoud Sidi Amar, président des déplacés internes du quartier Algafiate, souligne que « le marché n’est pas alimenté, les prix flambent alors que les revenus sont faibles. Il faut assurer la sécurité alimentaire, trouver des abris et créer des couloirs humanitaires pour faciliter l’acheminement des vivres ».
De son côté, Almahadi Intabakat, secrétaire général de la mairie de Ménaka, tire la sonnette d’alarme : « La situation est extrêmement difficile. L’ensemble des cercles s’est déplacé vers le chef-lieu régional. Ces milliers de déplacés vivent dans des conditions précaires, sans nourriture suffisante, sans eau potable ni soins de santé. » Selon lui, la dernière assistance significative dans la région remonte au début du mois d’août, à travers le Programme alimentaire mondial (PAM).
Des efforts limités par le manque de financement
Malgré l’engagement des autorités et des partenaires humanitaires, les moyens restent insuffisants. Selon les rapports de l’OCHA, qui n’a pas répondu à notre demande d’interview mais a transmis des documents de référence, la mise en œuvre du Plan de réponse humanitaire 2025 nécessiterait 771,3 millions de dollars US.
« L’action humanitaire est mise à rude épreuve au Mali, où des milliers de personnes vivent déplacées à l’intérieur du pays ou réfugiées à l’étranger à cause de l’insécurité persistante », rappelle Djibrilla Touré, journaliste spécialiste des questions humanitaires. Il souligne que, malgré les efforts pour distribuer des vivres, assurer l’accès à la santé, à l’eau potable et à l’éducation d’urgence, les défis logistiques et sécuritaires freinent les interventions.
Une crise aux conséquences durables
Au-delà de l’urgence immédiate, la crise a des répercussions profondes sur le tissu social et économique. Les activités agricoles sont interrompues, le commerce ralentit, le chômage s’accroît. L’éducation est lourdement affectée : dans certaines zones, plusieurs années de scolarité ont déjà été perdues.
Les communautés hôtes, elles-mêmes vulnérables, partagent leurs maigres ressources avec les déplacés, ce qui accentue la pression et alimente parfois des tensions intercommunautaires.
Beaucoup d’observateurs s’accordent : seule une amélioration durable de la sécurité, combinée à un renforcement des services sociaux de base et à une solution politique au conflit, pourra permettre de sortir de ce cycle de crises humanitaires répétées.
Par Djibrilla Touré, Correspondant á Dakar