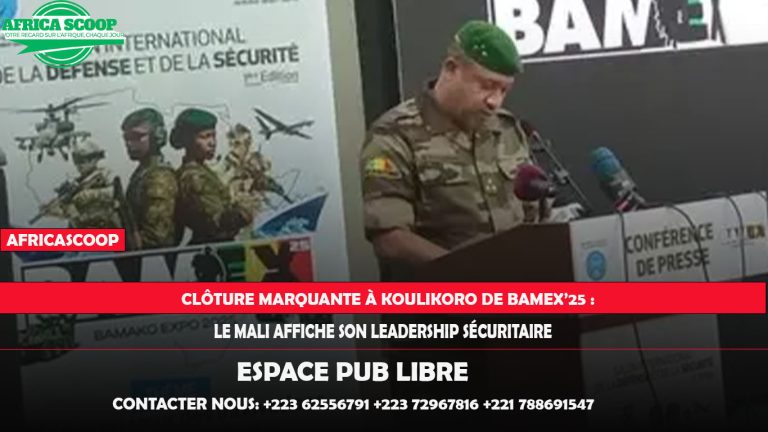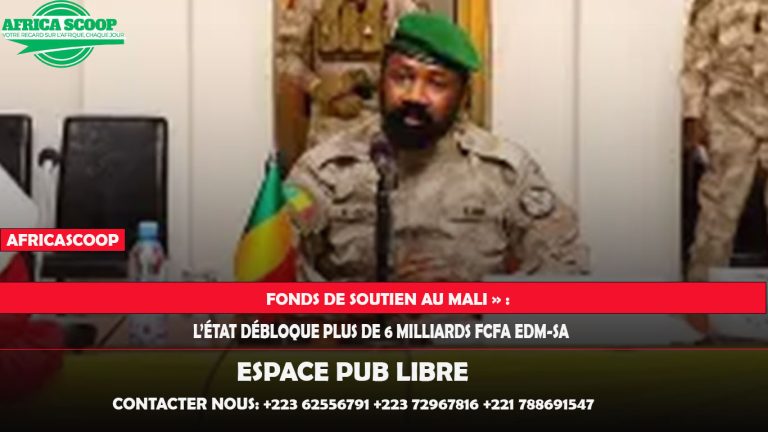Accusée d’abriter sur son territoire des groupes terroristes, la Mauritanie a choisi le silence comme réponse. Depuis quelque temps déjà, des voix affirment que ce voisin du Mali offrirait soutien et refuge à des narcotrafiquants et à des combattants armés.
Face à cette situation, Bamako a pris une décision radicale : fermer sa frontière avec la Mauritanie, et ce, en pleine période de transhumance. Une mesure aux conséquences lourdes, car chaque année, des éleveurs mauritaniens traversent le territoire malien pour accéder à l’eau et au pâturage indispensables à leurs troupeaux.
Cette fermeture n’est pas un hasard. Elle intervient à un moment stratégique, révélant la volonté du Mali d’exprimer son mécontentement vis-à-vis d’une coopération jugée déséquilibrée. Le message est clair : la complicité présumée envers les groupes armés ne sera plus tolérée.
Sur les réseaux sociaux, les réactions ne se font pas attendre. Certains responsables mauritaniens appellent à la réouverture urgente des frontières, d’autres plaident pour la clémence des autorités maliennes. La tension monte, les malentendus s’accumulent.
Mais faut-il vraiment en arriver là ? Les différends entre États voisins devraient pouvoir se résoudre par le dialogue, et non par la rupture. Le Mali et la Mauritanie partagent une histoire, une culture et des intérêts communs trop profonds pour être sacrifiés sur l’autel des incompréhensions.
Il est temps, pour les deux gouvernements, de renouer le fil du dialogue, de dépasser les rancunes diplomatiques et de penser d’abord aux populations, qui ne demandent qu’une chose : vivre en paix, ensemble.
Par Djibrilla Touré